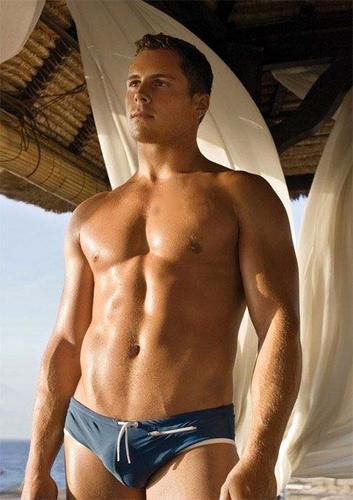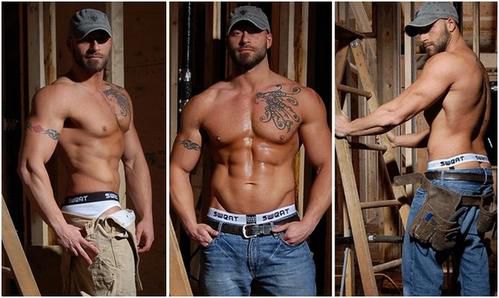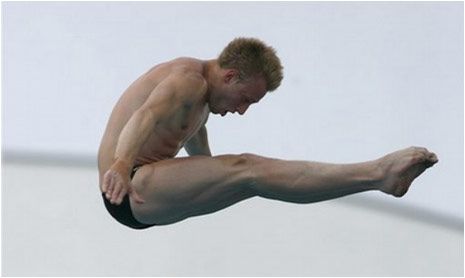L'enfant mort dans la prison du Temple, le 8 juin 1795, était-il bien Louis XVII, héritier du trône et fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette ? Sur sa mort, les rumeurs les plus folles ont
couru : échanges d'enfants, prétendants surprise, impostures et retournements de situations… Durant plus de deux siècles, le mystère a perduré. Où en est-on aujourd'hui
?
La naissance d'un mystère
L'enfant du donjon du Temple
Le 13 août 1792, le maire de Paris conduit la famille royale vers son ultime résidence, la prison du Temple. Le Dauphin, qui n'a alors que sept
ans, passe des fastes de Versailles au donjon du Temple. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné : le Dauphin devient Louis XVII. Héritier du trône mais toujours enfermé, il est rapidement
séparé du reste de sa famille. On le confie au cordonnier Simon qui l'éduque comme un sans-culotte. En 1793, pendant le procès de Marie Antoinette, il témoigne contre sa
mère : inceste, incitation à la débauche, vices en tout genre sont reprochés à la reine, qui est exécutée le 16 octobre 1793.

En 1794, en pleine Terreur jacobine, le traitement de l'enfant est durci. Le petit Louis est livré à lui-même : gardé par quatre commissaires, il vit dans un cachot que la lumière du jour
n'atteint pas. Il ne se lave pas, ne se change pas, vit misérablement, et bientôt, son état de santé s'aggrave. Au mois de mai 1795, le docteur Desault, médecin-chef de l'Hôtel-Dieu, raconte :
"J'ai trouvé un enfant idiot, mourant, victime de la douleur la plus abjecte, de l'abandon le plus complet, un être abruti par les traitements les plus cruels et qu'il est impossible de
rappeler à l'existence." Le 8 juin 1795, après de longs mois d'agonie, l'enfant meurt dans les bras d'un de ses geôliers. L'autopsie, pratiquée le lendemain, révèle que
l'enfant est mort d'une tuberculose généralisée très douloureuse. Il n'avait que 10 ans.

Les rumeurs
Les hypothèses les plus fantaisistes mais aussi les thèses les plus solides n'ont cessé d'affirmer que le petit garçon mort à la
prison du Temple n'était pas Louis XVII. Ainsi, certains pensent que, pour des raisons politiques, on aurait substitué à l'orphelin du Temple, qui serait décédé quelques mois avant, un enfant
malade qui serait, lui, mort le 8 juin 1795. D'autres soutiennent que Louis XVII ne serait pas mort à la prison du Temple mais qu'il aurait été sauvé afin de préserver l'avenir de la dynastie. Il
faut avouer que tout a été fait pour laisser libre cours à l'imagination des uns et des autres. Prétendument enseveli dans le cimetière Saint-Marguerite, le corps n'a jamais été retrouvé et pour
cause : il a été jeté dans une fosse commune.

Dès le 12 juin, la "Gazette française" rapporte : "La mort du fils de Louis XVI a donné lieu à divers bruits, à une foule de fables plus
absurdes les unes que les autres. Les uns prétendent que cette mort est un fait à plaisir, que le jeune enfant est plein de vie, qu'il y a très longtemps qu'il n'est plus au Temple et qu'une des
principales conditions de la paix conclue avec la Prusse, les Chouans et les Vendéens était de confier ce jeune orphelin aux puissances étrangères. D'autres assurent au contraire qu'il y a plus
d'un an qu'ils avaient la certitude que l'enfant était mort empoisonné. Le plus grand nombre des incrédules, cependant, reportent tout l'odieux d'un crime imaginaire sur le
gouvernement."
Les faux dauphins
Au fil du temps, une multitude d'imposteurs ont prétendu être Louis-Charles de France ou descendre de lui. Parmi eux, les plus célèbres restent
Jean-Marie Hervagault, Mathurin Bruneau, Claude Perrin et Karl-Wilhem Naundorff.
-
Jean-Marie Hervagault, le premier imposteur
Le premier "faux dauphin" à se manifester est Jean-Marie Hervagault. D'origine modeste, fils d'un tailleur de Saint-Lô, c'est un
spécialiste du changement d'identité. Son physique avenant lui permet toutes les audaces. Au cours de ses pérégrinations, il s'invente des origines prestigieuses, se faisant passer tantôt pour le
fils du prince de Monaco, tantôt pour celui du duc de Madrid, ou encore pour le neveu du comte d'Artois et de Marie-Antoinette. Parfois, il va jusqu'à se travestir en jeune fille. En 1801, il n'a
guère de mal à convaincre une poignée de nobles champenois qu'il est le légitime héritier du Trône. Le triomphe est bref. Le 16 septembre 1801, à Vitry-le-François, il est arrêté. En 1806, la
justice l'intègre au bataillon colonial garnissaire de Belle-Ile mais il parvient rapidement à s'enfuir. Traqué par la police, il est à nouveau incarcéré et meurt à la prison de Bicêtre le 8 mai
1812.
Sabotier et prince de sang
Mathurin Bruneau né à Vézins, fils d'un sabotier angevin, se fait passer pour un mendiant de naissance royale. En 1802, il se rend au château
d'Angrie où il se fait héberger et soigner comme un prince par M. de Turpin, auprès de qui il se fait passer pour le Dauphin. Quelques mois plus tard, la supercherie est découverte par les
châtelains voisins. On le retrouve ensuite fantassin puis voleur à New York et à Baltimore. En 1815, de retour d'Amérique, il réclame le trône à son "oncle", Louis XVIII, qui, bien sûr, le lui
refuse. Il tente alors de prouver sa véritable identité en écrivant à sa "sœur" la Duchesse d'Angoulême qui lui envoie une liste de questions auxquelles elle seule et son véritable frère
pourraient répondre. Il n'a jamais reçu cette lettre conservée aujourd'hui aux Archives Nationales. Emprisonné au Mont St-Michel pendant cinq ans, il y meurt en 1825.
Le caméléon
Tout comme les autres "faux dauphins", Claude Perrin est un aventurier. On ne sait comment il parvient à se faire délivrer, à Arles, un passeport
sous le nom de Louis-Charles Bourbon. En 1820, il est arrêté dans la principauté de Modène et écroué, sans être passé en jugement, à la prison Santa-Margharita. Une fois relâché, on le retrouve
sous le nom de Baron Augustin Pictot, Colonel Gustave, Henri Hébert ou encore Comte de Richemont. Dénonçant l'arrivée de Louis-Philippe au pouvoir, il se fait remarquer et est enfermé à
Sainte-Pélagie en 1833. Inculpé de cinq chefs d'accusation dont "complot contre la vie du roi et la sûreté de l'Etat", il comparaît en octobre 1834 devant les assises de la Seine. Condamné à
douze ans de détention, il s'évade aussitôt. Se proclamant duc de Normandie, il finit tranquillement sa vie, allant de château en château et abusant les uns et les autres. Il s'éteint en 1853,
auprès de la comtesse d'Apcher, chez qui il s'est établi.
Le plus crédible
D'origine prussienne, Karl-Wilhelm Naundorff, horloger à Spandau, faux-monnayeur à Brandebourg, fondateur d'une secte teintée de christianisme à
Londres, a fréquenté toutes les prisons d'Europe. Après avoir tenté en vain d'être reçu, à Prague, par la duchesse d'Angoulême, sœur de Louis XVII, il débarque à Paris en 1833 et parvient a se
faire reconnaître comme étant le Dauphin par l'ancienne femme de chambre de Louis XVII. Elégant, cultivé, il rassemble un flot de partisans. En 1836, il assigne en justice la duchesse
d'Angoulême, afin d'obtenir les biens revenant à Louis XVII. Il est alors expulsé en Angleterre, puis aux Pays-Bas et meurt finalement à Delft en 1845. Sur sa tombe, le gouvernement hollandais a
tout de même fait graver : "Ci-gît Louis de Bourbon, Duc de Normandie." Naundorff est le seul de ces quatre imposteurs à être parvenu à convaincre un véritable cercle de fidèles de son vivant.
Une mystification qui aura une suite, puisque ses descendants saisiront en vain la justice française en 1851 et 1874.

La fin d'une énigme
Les tribulations du cœur
Au moment de l'autopsie, en 1795, le docteur Pelletan, médecin-légiste, parvient à subtiliser le cœur de l'enfant avant que le corps ne soit
recousu. Il le conserve dans une urne de cristal, où a été versé de l'esprit-de-vin (alcool éthylique). Dix ans plus tard, tout l'alcool présent dans l'urne s'est évaporé. Le cœur connaît alors
une destinée troublée : volé par l'un des élèves du médecin, il lui est restitué avant d'être remis à Mgr de Quelen, archevêque de Paris. Fin juillet 1830, le cœur est pris par un insurgé lors
des manifestations de Juillet. L'urne renfermant le cœur se brise et le cœur est perdu dans la cour de l'archevêché. L'insurgé, ayant conservé les documents accompagnant le cœur, connaît sa
provenance. Il décide alors d'avertir le docteur Pelletan fils de la perte du cœur : ce dernier le retouve miraculeusement sous un tas de sable. À la mort de Philippe-Gabriel Pelletan, en 1879,
le cœur entre en la possession de l'un de ses amis, Prosper Deschamps. Après de nombreuses aventures, la relique est finalement donnée au roi don Carlos d'Espagne, plus proche parent des
Bourbons, en 1895, à l'occasion du centenaire de la mort de Louis XVII. Près d'un siècle plus tard, en 1975, les Bourbons d'Espagne remettent le cœur au duc de Bauffremont, président du Mémorial
de France à Saint-Denis.
Le verdict de la science
En avril 2000, des tests ADN sont pratiqués par deux
laboratoires de renommée internationale. Les experts, le professeur Jean-Jacques Cassiman de la KU Leuven en Belgique et le docteur Berndt Brinkmann de l'université allemande de Münster,
analysent le cœur en comparant son ADN à celui de la reine Marie-Antoinette. Le verdict tombe : le cœur est celui d'un membre de la même famille. Les conclusions des recherches sont présentées à
la presse le 19 avril 2000 et exposées dans un livre de l'historien Philippe Delorme, "Louis XVII, la vérité".

Le 8 juin 2004, les restes de l'enfant royal sont déposés dans l'ancienne nécropole royale de Saint-Denis. La cérémonie est organisée par le
Mémorial de France à Saint-Denis et présidée par le plus proche parent actuel du Dauphin, le prince Louis de Bourbon. Sont présents de nombreux Bourbons mais aussi plusieurs ambassadeurs et
personnalités (Hélène Carrère d'Encausse, Buzz Aldrin, J.J. Aillagon...). Pour la plupart des spécialistes, l'analyse ADN du cœur, conjuguée avec l'enquête menée sur son origine et ses
tribulations, est suffisante pour attester de la mort du prince au Temple. Mais pour certains, des doutes subsistent toujours.